Cher Jean-Pierre, entre deux tours de corvée de bois (eh oui, il faut penser à l'hiver...), tu ne me vexes pas le moins du monde, et je te remercie de ton message, au contraire. Tu as raison aussi pour les précisions entre parenthèses : cela alourdit, mais c'est que je ne veux pas paraître trop ésotérique, et indiquer rapidement ici et là la direction du sens que j'utilise, afin de rester tout à fait compréhensible malgré la complexité des sujets abordés, serait-ce au prix d'un petit effort. S'il y a des phrases bancales comme tu dis, je veux bien savoir lesquelles : je les corrigerai ! Il est vrai que j'écris assez vite et ne me relis pas moi-même toujours autant qu'il faudrait (comme quoi les critiques faites aux uns valent pour tout le monde, y compris ceux qui les formulent : voilà l'esprit de forum-train qu'il ne faut pas oublier !).
@Rapide : voilà justement un bon exemple de ce que j'ai écrit : "Rendons à César..." (Matthieu, XXII,21).
L’Église catholique malgré ses errements, ses compromissions avec les pouvoirs en place, ses tentations politiques, etc.,etc. a toujours su "garder le contact" avec le message originel, d'une façon ou d'une autre, et se reprendre même si quelque fois un peu tard, ou par la force des choses. Et c'est ce qui nous a permis l'évolution que l'on sait, cahin-caha, même avec beaucoup de désastres. C'est exactement cela ("Rendons à César...) qui manque cruellement à certaine autre "religion" (guillemets de rigueur, tant c'est une Loi plus qu'une Foi, et un système total à vocation conquérante et prédatrice). De même que le sens critique, de l'introspection, de la remise en cause, etc. Qui d'autre se "repent", et porte pour son propre compte la responsabilité ? Qu'on le veuille ou non, que cela plaise ou pas, le cœur du christianisme, à savoir l'Incarnation, le Dieu qui se fait homme et pas qui l'écrase ou le soumet, ou bien lui est rédhibitoirement Autre, est en soi une "subversion" extraordinaire. En prime : la rupture du cercle infernal de la violence (bouc émissaire / mimétisme), cf. l’œuvre de René Girard, remarquable.
Retour à la corvée, et je reviens...
La langue française
Re: La langue française
Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit. (La Rochefoucauld)
-

Didier - Vidéo De Galop
- Messages: 5650
- Âge: 70
- Enregistré le: 27 Avr 2009, 08:20
- Localisation: Région nantaise
Re: La langue française
tyrphon a écrit:Lebrac a écrit:Lebrac a écrit:A propos: "c'est des" que l'on voit et entend partout, cela ne vous troue pas le c.l ?
Note de la modération: le vocable fondement eut été plus approprié dans cette locution, afin qu'elle n'apparût point tant triviale.
Désolé, je pensais que l'allusion à "Litteul Kévin" était évidente.
Et puis, "ça me troue le fondement", de quoi cela aurait-il l'air?
Admirer ma façon de ferrailler sur tous les fronts, là où certains creusent imperturbablement leur sillon, sans se préoccuper de la valetaille sarcastique qui tournoie autour d'eux...
C'est le mot "c.l" qui pose problème? Encore cette merde de morale judéo-chrétienne!

Observateur désabusé
Prince Héréditaire du Bruxelbourg et Saroulmapoul délocalisé
La Principauté s'oppose fermement à l'annexion du Koikilenkoutt. Vive le Koikilenkoutt libre
Prince Héréditaire du Bruxelbourg et Saroulmapoul délocalisé
La Principauté s'oppose fermement à l'annexion du Koikilenkoutt. Vive le Koikilenkoutt libre
-

Rockandrail - Vertueux Du Goulag
- Messages: 18622
- Âge: 72
- Enregistré le: 13 Déc 2007, 23:55
- Localisation: Royan
Re: La langue française
Si ce bon prêcheur, ne fut pas réduit aux évangiles, mais compris après le "discours sur la colline" le monde fut moins mauvais, sauf que "l'homme" interprète les discours théologiques à sa convenance!
(merguez et cotes de porc, juteuses et à point!)
(merguez et cotes de porc, juteuses et à point!)
-
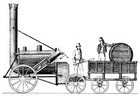
xc656 - Bavard
- Messages: 1117
- Âge: 69
- Enregistré le: 16 Aoû 2011, 14:57
- Localisation: Taupont 56
Re: La langue française
xc656 a écrit:Si ce bon prêcheur, ne fut pas réduit aux évangiles, mais compris après le "discours sur la colline" le monde fut moins mauvais, sauf que "l'homme" interprète les discours théologiques à sa convenance!
(merguez et cotes de porc, juteuses et à point!)
Il est normal que l'Homme interprète les discours théologiques à sa convenance puisqu'il en est l'auteur. Les religions sont les seuls programmes politiques totalitaires qu'aucune guerre, crise économique ni révolution n'aient réussi à abattre. Pas cons les religieux!

En plus, le donneur d'ordre n'est pas planqué dans un bunker que l'on peut assiéger et réduire. Il est dématérialisé. Pratique.
Observateur désabusé
Prince Héréditaire du Bruxelbourg et Saroulmapoul délocalisé
La Principauté s'oppose fermement à l'annexion du Koikilenkoutt. Vive le Koikilenkoutt libre
Prince Héréditaire du Bruxelbourg et Saroulmapoul délocalisé
La Principauté s'oppose fermement à l'annexion du Koikilenkoutt. Vive le Koikilenkoutt libre
-

Rockandrail - Vertueux Du Goulag
- Messages: 18622
- Âge: 72
- Enregistré le: 13 Déc 2007, 23:55
- Localisation: Royan
Re: La langue française
Plus la place de mettre une bûche ! Bon, ça c'est fait…
***
« Alors, aurait-on pu avoir les bienfaits du message chrétien de liberté et de responsabilité individuelles sans avoir les méfaits de la notion de Dieu Unique? That is the question... »
En effet, that is a good question, Jean-Pierre… Avec ça : extrêmement difficile (autant dire que c'est une question essentielle). Je n'y répondrai pas d'un coup, même en simplifiant à l'extrême (je signale en passant que je problématise bien plus que je n'affirme, au long de cette discussion).
Donne moi un peu de temps, et j'y viens...
***
« Alors, aurait-on pu avoir les bienfaits du message chrétien de liberté et de responsabilité individuelles sans avoir les méfaits de la notion de Dieu Unique? That is the question... »
En effet, that is a good question, Jean-Pierre… Avec ça : extrêmement difficile (autant dire que c'est une question essentielle). Je n'y répondrai pas d'un coup, même en simplifiant à l'extrême (je signale en passant que je problématise bien plus que je n'affirme, au long de cette discussion).
Donne moi un peu de temps, et j'y viens...
Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit. (La Rochefoucauld)
-

Didier - Vidéo De Galop
- Messages: 5650
- Âge: 70
- Enregistré le: 27 Avr 2009, 08:20
- Localisation: Région nantaise
Re: La langue française
Je suis impatient d"avoir ton point de vue!
Quand même, je me demande si un administrateur ne devrait pas scinder ce fil en deux (ou même en trois si on pense à son malheureux initiateur!), quitte à dupliquer deux ou trois messages. Encore une fois, le titre ne correspond plus avec le sujet!
Quand même, je me demande si un administrateur ne devrait pas scinder ce fil en deux (ou même en trois si on pense à son malheureux initiateur!), quitte à dupliquer deux ou trois messages. Encore une fois, le titre ne correspond plus avec le sujet!
Modifié en dernier par tyrphon le 12 Aoû 2012, 18:02, modifié 1 fois.
Jean-Pierre "Tyrphon" Dumont
Plutôt bobo que gros beauf,
plutôt pigeon que charognard.
http://tyrphon-trains.fr/.
Plutôt bobo que gros beauf,
plutôt pigeon que charognard.
http://tyrphon-trains.fr/.
-

tyrphon - Bavard
- Messages: 2158
- Âge: 81
- Enregistré le: 14 Jan 2008, 17:25
- Localisation: Rueil-Malmaison
Re: La langue française
Comme "corvée de bois", par exemple ? 


Il est dit parfois que toutes les guerres ne sont que des guerres de religion. Alors dites-moi le nom de ce Dieu qui les autorise à tuer l'amour (Apologue d'Alegranza)
autre activité
autre activité
-

gib - Votre Dévoué Gib
- Messages: 4438
- Âge: 72
- Enregistré le: 17 Déc 2007, 16:25
- Localisation: Fessenheim
Re: La langue française
La notion d'un dieu unique n'est pas elle-même malfaisante si le dieu est un personnage "buvable," sexy et sympa. Du genre du grand Pan des grecs. De plus, elle est logique du fait que, comme les multiples particules qui s'emboîtent tant bien que mal dans la théorie standard, les dieux multiples de la nature des mythologies anciennes nécessitaient leur "supercorde" au bout d'un certain nombre de siècles de spéculations et de craintes superstitieuses. Hormis la théorie M qui tendrait à le congédier, le dieu unique est encore la meilleure représentation d'un saut quantique originel. Pour essayer de répondre à la question de tyrphon à ma manière, je dirais que le christianisme aurait pu devenir une religion tout à fait sympa, autant qu'une religion puisse l'être à un athée, s'il ne s'était pas contenté de replâtrer le dieu des juifs et s'en soit créé un à sa mesure ...
Nous n'évoquerons même pas le dieu de l'islam qui n'est qu'une dégénérescence politico-mortifero-totalitaire de l'idée de transcendance.
Nous n'évoquerons même pas le dieu de l'islam qui n'est qu'une dégénérescence politico-mortifero-totalitaire de l'idée de transcendance.
- Rapide 424
- Bavard
Re: La langue française
Dommage que dans les bénitiers ce soit de l'eau bénite! Un peu de vin ferait du bien aux paroissiens ! Pas de soucis pour nous, on attaque le deuxième carton de "berticot", six bouteilles d'un très bon bordeaux!
-
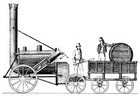
xc656 - Bavard
- Messages: 1117
- Âge: 69
- Enregistré le: 16 Aoû 2011, 14:57
- Localisation: Taupont 56
Re: La langue française
Il y plusieurs éléments à considérer en préalable à une tentative de "réponse" (éléments déjà un peu préparés supra, avec cette drôle de bêbête : "l'onto-theo-logie", l'ontologie / théologie).
Je vais essayer de les prendre un à un, un par message. Il faudra être patient, et je ne suis pas certain de parvenir au but de façon tant soit peu adaptée ici. Nous verrons bien, ceci est une sorte d'expérience… un peu comme une tentative incertaine de montage d'un truc en laiton… Pourquoi pas ?
***
Parlons de "l'ontologie", d'abord.
Notre civilisation combine plusieurs racines, racines dont la grecque est la première. Cette racine grecque, puis gréco-romaine, s'est appropriée (plus que l'inverse) une racine judaïque à travers le christianisme, situé au carrefour des trois (hellénisme, Rome, Jérusalem).
Notre civilisation est aussi, c'est très notable, le fruit de reprises* de ces racines d'époque en époque : Moyen-âge, qui est une vraie renaissance malgré l'image qu'on s'en fait trop souvent (il est en vérité une succession de "renaissances"), Renaissance, Temps modernes, etc.
La Grèce c'est, au sommet de sa création (et tout autant à la source de celle-ci), la pensée dite "philosophique" (mot grec), d'où presque tout ce que nous sommes provient, à commencer par les sciences modernes (il n'y a qu'à voir la part des racines grecques dans la terminologie des sciences ; "technique" vient de tekné ; les premiers "philosophes" (terme qui n'existait pas à ce moment là) se nomment les "physikoï", soit : les "physiciens", de "physis" qu'on traduit habituellement par "nature", mais attention, c'est une très grosse approximation, qui enduit d'erreur plus qu'autre chose …).
…).
Cette pensée originale évolue dans un monde où le "divin" est omniprésent, mais sur un mode dont on a plus guère idée **. Important à noter pour la suite.
Ce qui s'appellera tardivement "philosophie" à proprement parler (à partir seulement de Platon, soit au moment de sa floraison terminale en Grèce) s'applique à l'étude de "l'étant" (participe substantivé, voir la suite avant de se décourager), cherchant "ce qu'il est", "par où il est", bref : elle cherche "l'être de l'étant", bref : l'être "tout court" ce qui proprement "est" dans tout "étant", dans toute chose "qui est".
Un "étant" (la table, le soir, cet homme, un souvenir…) n'est pas pris "comme il vient", mais il est questionné en son "être". "Ti estin…" est LA question récurrente : "Qu'est-ce que c'est que… ?".
De tous les verbes, celui qui soutient tous les autres et les rend possibles (même en japonais où il n'existe pas, mais c'est une autre histoire…), c'est le verbe "être" ; toutes choses, si disparates soient-elles, ont en commun une et une seule chose : le fait d'être ; même l'absence, ou le faux, ou l'imagination sont encore un mode d'être ! Et cela, c'est "la merveille des merveilles" pour un Grec, c'est la cause d'un éternel "étonnement" (le thaumazein : "pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ?"), c'est le "moteur" de leur interrogation (avec la Beauté qui ne peut être qu'un reflet de la "vérité" — je résume, hein, mais même ainsi ledit "miracle Grec" est assez extraordinaire).
Et nous revoici en plein dans la question du langage, et de la grammaire…
Le maître mot grec pour cela (étant/être) c'est "to on". La grammaire grecque le détermine comme "metoké", ce que les latins appelleront "participe", qui… participe du côté du nom et du côté du verbe.
"étant" s'entend soit nominalement ("un" étant donné) : par exemple une fleur, soit verbalement (le fait d'être) : par exemple le fait de fleurir, "le" fleurir. Nominal et verbal : la forme participiale. Elle est particulièrement puissante et structurante en Grec ancien… et partant pour la pensée en occident (la provenance la plus initiale de cette "manière" est indo-européenne).
« La parole grecque est en effet la seule où ce que la grammaire appellera le mode participe donne le ton, et ceci à partir du verbe des verbes, du moins en grec, que lui est le verbe être. En latin esse n'a pas de participe. Le mot ens est une invention tardive, fabriquée gauchement pour traduire le grec "on". En français, être ne s'emploie plus qu'à titre auxiliaire. L'anglais being consonne bien avec le grec "on", mais plus au profit de l'étant que de l'être. » (Jean Beaufret, Dialogues avec Heiddegger).
D'où "l'ontologie" : le discours (logos, logie) de fond sur "l'être de l'étant" (on, ontos). Littéralement : la "science" qui cherche "to on è on", l'étant/être en tant que être/étant.
A suivre, plus du côté "théologie"… si vous le voulez bien !
Et bonne dégustation aux bretons...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* cette notion de "reprise", et donc de "secondarité" dans les racines (Europe / monde antique) est une chose absolument unique dans l'histoire des civilisations, elle est déterminante pour "l'esprit européen", et partant occidental. Cf. J-F Mattéi et surtout, surtout, l'excellent Rémy Brague : "L'Europe voie romaine" http://www.amazon.fr/Europe-voie-romain ... 216&sr=1-2
** Si je peux me permettre un conseil, une lecture et une seule, ce serait l'admirable et inégalé livre de Walter F. Otto : "Les dieux de la Grèce" (Payot) http://www.amazon.fr/dieux-Gr%C3%A8ce-W ... 960&sr=8-1
Je vais essayer de les prendre un à un, un par message. Il faudra être patient, et je ne suis pas certain de parvenir au but de façon tant soit peu adaptée ici. Nous verrons bien, ceci est une sorte d'expérience… un peu comme une tentative incertaine de montage d'un truc en laiton… Pourquoi pas ?
***
Parlons de "l'ontologie", d'abord.
Notre civilisation combine plusieurs racines, racines dont la grecque est la première. Cette racine grecque, puis gréco-romaine, s'est appropriée (plus que l'inverse) une racine judaïque à travers le christianisme, situé au carrefour des trois (hellénisme, Rome, Jérusalem).
Notre civilisation est aussi, c'est très notable, le fruit de reprises* de ces racines d'époque en époque : Moyen-âge, qui est une vraie renaissance malgré l'image qu'on s'en fait trop souvent (il est en vérité une succession de "renaissances"), Renaissance, Temps modernes, etc.
La Grèce c'est, au sommet de sa création (et tout autant à la source de celle-ci), la pensée dite "philosophique" (mot grec), d'où presque tout ce que nous sommes provient, à commencer par les sciences modernes (il n'y a qu'à voir la part des racines grecques dans la terminologie des sciences ; "technique" vient de tekné ; les premiers "philosophes" (terme qui n'existait pas à ce moment là) se nomment les "physikoï", soit : les "physiciens", de "physis" qu'on traduit habituellement par "nature", mais attention, c'est une très grosse approximation, qui enduit d'erreur plus qu'autre chose
Cette pensée originale évolue dans un monde où le "divin" est omniprésent, mais sur un mode dont on a plus guère idée **. Important à noter pour la suite.
Ce qui s'appellera tardivement "philosophie" à proprement parler (à partir seulement de Platon, soit au moment de sa floraison terminale en Grèce) s'applique à l'étude de "l'étant" (participe substantivé, voir la suite avant de se décourager), cherchant "ce qu'il est", "par où il est", bref : elle cherche "l'être de l'étant", bref : l'être "tout court" ce qui proprement "est" dans tout "étant", dans toute chose "qui est".
Un "étant" (la table, le soir, cet homme, un souvenir…) n'est pas pris "comme il vient", mais il est questionné en son "être". "Ti estin…" est LA question récurrente : "Qu'est-ce que c'est que… ?".
De tous les verbes, celui qui soutient tous les autres et les rend possibles (même en japonais où il n'existe pas, mais c'est une autre histoire…), c'est le verbe "être" ; toutes choses, si disparates soient-elles, ont en commun une et une seule chose : le fait d'être ; même l'absence, ou le faux, ou l'imagination sont encore un mode d'être ! Et cela, c'est "la merveille des merveilles" pour un Grec, c'est la cause d'un éternel "étonnement" (le thaumazein : "pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ?"), c'est le "moteur" de leur interrogation (avec la Beauté qui ne peut être qu'un reflet de la "vérité" — je résume, hein, mais même ainsi ledit "miracle Grec" est assez extraordinaire).
Et nous revoici en plein dans la question du langage, et de la grammaire…
Le maître mot grec pour cela (étant/être) c'est "to on". La grammaire grecque le détermine comme "metoké", ce que les latins appelleront "participe", qui… participe du côté du nom et du côté du verbe.
"étant" s'entend soit nominalement ("un" étant donné) : par exemple une fleur, soit verbalement (le fait d'être) : par exemple le fait de fleurir, "le" fleurir. Nominal et verbal : la forme participiale. Elle est particulièrement puissante et structurante en Grec ancien… et partant pour la pensée en occident (la provenance la plus initiale de cette "manière" est indo-européenne).
« La parole grecque est en effet la seule où ce que la grammaire appellera le mode participe donne le ton, et ceci à partir du verbe des verbes, du moins en grec, que lui est le verbe être. En latin esse n'a pas de participe. Le mot ens est une invention tardive, fabriquée gauchement pour traduire le grec "on". En français, être ne s'emploie plus qu'à titre auxiliaire. L'anglais being consonne bien avec le grec "on", mais plus au profit de l'étant que de l'être. » (Jean Beaufret, Dialogues avec Heiddegger).
D'où "l'ontologie" : le discours (logos, logie) de fond sur "l'être de l'étant" (on, ontos). Littéralement : la "science" qui cherche "to on è on", l'étant/être en tant que être/étant.
A suivre, plus du côté "théologie"… si vous le voulez bien !
Et bonne dégustation aux bretons...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* cette notion de "reprise", et donc de "secondarité" dans les racines (Europe / monde antique) est une chose absolument unique dans l'histoire des civilisations, elle est déterminante pour "l'esprit européen", et partant occidental. Cf. J-F Mattéi et surtout, surtout, l'excellent Rémy Brague : "L'Europe voie romaine" http://www.amazon.fr/Europe-voie-romain ... 216&sr=1-2
** Si je peux me permettre un conseil, une lecture et une seule, ce serait l'admirable et inégalé livre de Walter F. Otto : "Les dieux de la Grèce" (Payot) http://www.amazon.fr/dieux-Gr%C3%A8ce-W ... 960&sr=8-1
Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit. (La Rochefoucauld)
-

Didier - Vidéo De Galop
- Messages: 5650
- Âge: 70
- Enregistré le: 27 Avr 2009, 08:20
- Localisation: Région nantaise
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités




